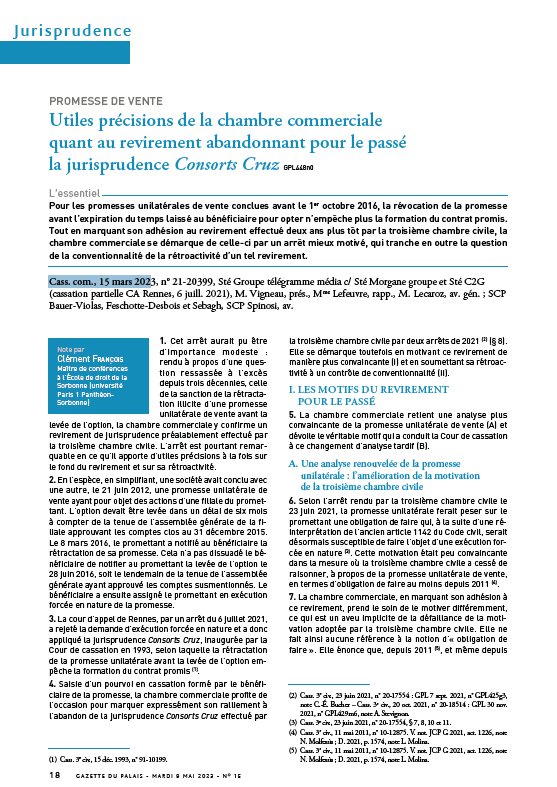Note sous Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, pourvoi n° 18-13.840 :
Tranchant une question d’interprétation débattue, la Cour de cassation décrète le caractère exclusif du régime de responsabilité du transporteur ferroviaire en cas de dommage corporel issu du règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sans même saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. Cette substitution du régime européen au régime jurisprudentiel français de l’obligation de sécurité de résultat emportera plusieurs conséquences défavorables aux victimes dont la première est actée par l’arrêt du 11 décembre 2019 : la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure redevient une cause exonératoire du transporteur.
Mise à jour du 01/02/2021 : Retrouvez ci-dessous mon commentaire de cet arrêt, publié au Recueil Dalloz (D. 2020, p. 188) il y a plus d’un an et désormais disponible en libre accès sur mon site sur le fondement de l’article L. 533-4, I, du Code de la recherche.
1.- En l’espèce, le 3 juillet 2013, une personne munie d’un titre de transport a été victime d’un écrasement du pouce à la suite de la fermeture d’une porte automatique du train dans lequel elle se trouvait. Elle a assigné la SNCF en réparation de ses préjudices.
Pour obtenir une exonération partielle de sa responsabilité, la SNCF invoquait l’existence d’une faute d’imprudence de la victime sur le fondement de l’article 26, § 2, b), de l’annexe I du règlement CE n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 selon lequel le transporteur ferroviaire est déchargé de sa responsabilité « dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur ».
2.- La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 21 décembre 2017[1], a néanmoins déclaré la SNCF entièrement responsable en refusant de prendre en compte la faute simple de la victime. Pour justifier l’absence d’exonération partielle, la cour d’appel avait retenu que l’article 11 dudit règlement posait « un principe général de responsabilité du transporteur ferroviaire au-dessous duquel les États membres ne peuvent légiférer ». En effet, cet article prévoit que le régime européen de responsabilité des transporteurs ferroviaires s’applique « sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis ». Or, selon un principe dégagé par la Cour de cassation en 2008, « le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure[2] ». La cour d’appel en a déduit que le régime du règlement européen devait être écarté au profit du droit français de la responsabilité civile plus favorable à la victime en ce qu’il ne permet pas l’exonération partielle du transporteur en cas de faute simple du voyageur.
3.- Contestant cette interprétation de l’article 11 du règlement, la SNCF s’est pourvue en cassation. Selon elle, « il résulte de cette disposition d’harmonisation maximale que le droit interne n’a pas vocation à se substituer au régime de responsabilité instauré par le règlement, mais seulement à le compléter lorsqu’il permet une plus grande indemnisation, c’est-à-dire au seul stade de l’évaluation du dommage ».
4.- La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles 11 du règlement du 23 octobre 2017 et 26 de son annexe I, L. 2151-1 du code des transports et 1147 ancien du code civil. Selon la Haute juridiction, il résulte des trois premiers de ces textes que « le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime ». « En conséquence », poursuit la Cour de cassation, « il y a lieu de modifier la jurisprudence » empêchant le transporteur ferroviaire de s’exonérer partiellement de sa responsabilité.
5.- Cet arrêt du 11 décembre 2019 fera date en ce qu’il décrète le caractère exclusif du régime européen de responsabilité des transporteurs ferroviaires de personnes en cas de dommage corporel (I). Cette solution inédite conduit la Cour de cassation à admettre de nouveau l’exonération partielle de la SNCF en cas de faute du voyageur ne présentant pas les caractères de la force majeure ; elle entraînera également un certain nombre d’autres conséquences défavorables aux victimes (II).
I. Le principe de l’application exclusive du régime européen
6.- Le règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 instaure au sein de l’Union européenne un régime de responsabilité des transporteurs ferroviaires en cas de dommage causé aux voyageurs ou à leurs bagages. La particularité de ce régime est qu’il est défini en grande partie par renvoi à certaines dispositions, reproduites en annexe du règlement, de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans sa version modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999. Cette convention a instauré des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (RU-CIV). Le règlement de 2007, en reprenant certaines de ces règles, a étendu leur champ d’application aux transports internes aux États membres à compter du 3 décembre 2009[3].
7.- Dès l’adoption de ce règlement, la doctrine s’est interrogée sur son articulation avec les régimes nationaux de responsabilité qui régissaient jusqu’à lors les transports internes. La Cour de cassation, par cet arrêt du 11 décembre 2019, rejette clairement toute option au profit de la victime (A) et confère par conséquent un caractère exclusif au régime européen (B).
A. L’option écartée
8.- La clé de l’articulation entre le nouveau régime européen de responsabilité et les régimes nationaux réside dans l’article 11 du règlement : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I. » L’ambiguïté de cette disposition a été dénoncée par la doctrine française[4] : que faut-il entendre par la formule « sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis » ?
Selon une première interprétation, favorable aux victimes, les régimes nationaux de responsabilité peuvent cohabiter avec le régime européen dès lors qu’ils aboutissent à octroyer aux voyageurs une plus grande indemnisation. Ainsi, en l’espèce, le régime jurisprudentiel français de l’obligation de sécurité de résultat ne ménageait aucune possibilité d’exonération partielle pour la SNCF, contrairement au régime de responsabilité issu du règlement européen (art. 26, § 2, b). En ce sens, il est possible d’affirmer que le régime français de la responsabilité contractuelle aurait permis d’« octroyer au voyageur une plus grande indemnisation pour les dommages subis » et donc que l’article 11 du règlement offrait une option à la victime entre le droit européen et le droit national.
Au soutien de cette interprétation de l’article 11 du règlement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu deux arguments. D’abord, un argument téléologique : selon son préambule, le règlement a pour finalité de « sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires » et de fixer « un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine des transports » (considérants 1 à 3) ; le régime de responsabilité du règlement ne constituerait donc qu’un plancher en-deçà duquel les États membres ne peuvent légiférer. Ensuite, la cour d’appel a eu recours à un argument exégétique : si l’on suppose que le législateur européen est rationnel – postulat de toute interprétation exégétique[5] –, pourquoi aurait-il précisé à l’article 11 du règlement que le droit national se substitue, lorsqu’il est plus favorable, aux dispositions des RU-CIV en matière de détermination et d’évaluation des préjudices réparables, alors que les articles 29 et 30 des RU-CIV, reproduits en annexe du règlement européen, renvoient déjà au droit national en matière de détermination et d’évaluation des préjudices réparables ? En effet, selon l’article 29, « le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28 ». Selon l’article 30, § 2, « le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du paragraphe 1 est déterminé selon le droit national ». L’argument est convaincant : la seule interprétation qui permet de conférer un réel effet à la formule qui figure en incise à l’article 11 du règlement est celle qui conduit à accorder une option au voyageur entre le régime européen et les éventuels régimes nationaux plus favorables. L’interprétation alternative conduit à rendre cette incise superfétatoire par rapport aux articles 29 et 30, § 2, de l’annexe I du règlement.
9.- En l’absence d’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur cette question, l’ambiguïté de l’article 11 permettait donc à la Cour de cassation de retenir cette interprétation[6] et c’est d’ailleurs celle qu’avaient retenue plusieurs auteurs[7]. En outre, l’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inscrivait dans une jurisprudence constante de celle-ci[8] et au moins trois autres cours d’appel avaient retenu cette même interprétation[9].
La première chambre civile choisit pourtant de rejeter cette interprétation. Partant, elle écarte toute option au profit de la victime entre le régime national et le régime européen : « les dispositions du règlement devaient recevoir application » ; la cour d’appel a appliqué l’ancien article 1147 du code civil ; son arrêt est donc cassé.
B. L’exclusivité décrétée
10.- La première chambre civile précise le sens de la formule de l’article 11 du règlement : le régime européen de responsabilité des transporteurs ferroviaires de personnes s’applique « sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime ». Autrement dit, le droit français ne peut pas se substituer au régime européen, il peut tout au plus le compléter au stade de la détermination des préjudices réparables du voyageur et de leur évaluation. Par exemple, le droit français admet la réparation des préjudices moraux, ce qui n’est pas le cas des RU-CIV auxquelles renvoie le règlement européen[10], le voyageur peut donc invoquer le droit français pour obtenir réparation de ses préjudices moraux sur le fondement du régime de responsabilité issu du règlement. En revanche, les conditions de la responsabilité du transporteur et les causes d’exonération que celui-ci peut invoquer sont régies exclusivement par les dispositions du règlement européen.
11.- Il est surprenant que la Cour de cassation, qui a progressivement construit une obligation de sécurité de résultat très protectrice des voyageurs en matière ferroviaire[11], ait choisi de retenir l’interprétation de l’article 11 du règlement la moins favorable aux victimes. Cela surprend d’autant plus que la Cour de cassation ne manquait pas de moyens pour tenter de préserver un champ d’application le plus large possible à son régime jurisprudentiel. Elle aurait ainsi pu reprendre à son compte l’interprétation de l’article 11 du règlement qui était faite par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et qui était partagée par une partie des juges du fond et de la doctrine. Sans aller jusque-là, la Cour de cassation aurait pu a minima saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en interprétation, en espérant que celle-ci reconnaisse aux victimes une option entre le régime européen et les régimes nationaux plus favorables. Plus qu’un pouvoir, cette saisine était sans doute même un devoir en l’espèce. En effet, selon l’article 234 du traité CE, lorsqu’une question d’interprétation d’un règlement « est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice » d’une question préjudicielle[12]. La Cour de justice a écarté cette obligation de saisine dans trois hypothèses dont aucune ne semble présente en l’espèce : lorsqu’il n’est pas nécessaire de résoudre la difficulté d’interprétation pour trancher le litige ; lorsque la Cour de justice a déjà résolu la difficulté d’interprétation par un arrêt antérieur ou encore lorsque « l’application correcte du droit communautaire peut s’imposer avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée »[13]. Dès lors que l’interprétation rejetée par la Cour de cassation était celle retenue par au moins quatre cours d’appel et plusieurs auteurs, on peut difficilement prétendre que la solution retenue s’imposait avec une évidence telle qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable.
12.- L’interprétation retenue par la Cour de cassation compte néanmoins un certain nombre de soutiens. En effet, quelques auteurs[14] et au moins deux cours d’appel[15] s’étaient prononcés dans le sens d’une application exclusive du régime européen.
Cette solution a le mérite de tendre vers une plus grande harmonisation entre les droits des États membres, mais tel n’était pas l’objectif premier revendiqué par le législateur européen. Il apparaît singulier, selon nous, qu’un règlement édicté dans le but de « sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires » et de « protéger les consommateurs dans le domaine des transports »[16] puisse aboutir à un recul des droits des voyageurs en matière de réparation de leurs dommages corporels dans certains États membres comme la France.
13.- Une autre lecture de l’arrêt est possible, à l’aune de l’article L. 2151-1 du code des transports qui figure au visa. Selon certains auteurs, le règlement européen de 2007 permettait aux États membres de maintenir des régimes de responsabilité plus favorables aux voyageurs, mais c’est le législateur français qui aurait choisi, en adoptant l’article L. 2151-1 du code des transports, de conférer un caractère exclusif au régime européen[17].
L’arrêt commenté ne permet pas d’exclure cette thèse et pourrait même l’alimenter. La première chambre civile y énonce en effet que les dispositions du règlement de 2007 « sont reprises à l’article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE ».
Pour autant, il est permis de ne pas être convaincu par cette interprétation de l’article L. 2151-1 du code des transports. D’abord, le fait de rappeler dans une disposition du code des transports que certains voyages sont soumis au règlement européen n’implique pas, selon nous, que le législateur français ait entendu conférer un caractère exclusif au régime de responsabilité prévu par ce règlement. En effet, l’article L. 2151-1 ne reproduit pas les dispositions du règlement, mais se contente d’y renvoyer ; or l’article 11 dudit règlement, auquel le législateur a donc renvoyé, pouvait à l’époque être interprété comme maintenant les régimes nationaux plus favorables. Ensuite, cet article du code des transports est issu de la codification à droit constant[18] de l’article 3 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement dont l’exposé des motifs ne faisait aucune référence au régime de responsabilité des transporteurs ferroviaires en cas de dommage corporel[19]. Lors des débats en séance publique, le secrétaire d’État aux transports avait expliqué que « cet amendement vis[ait] à transposer [sic] dans notre droit le règlement européen sur les droits et obligations des voyageurs »[20]. Le législateur a voulu « transposer » en droit interne le règlement comme il transposerait une directive, il ne semble pas avoir voulu aller au-delà de ce que prévoit le règlement notamment en matière d’articulation avec les régimes nationaux de responsabilité. La finalité de cet amendement était simplement de déterminer l’applicabilité des dispositions non impératives du règlement de 2007 : le législateur a décidé que le règlement s’appliquerait intégralement aux entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence européenne[21] et que seules les dispositions impératives du règlement, parmi lesquelles figurent l’article 11, s’appliqueront aux autres entreprises ferroviaires[22]. Le législateur français ne semble donc pas avoir eu la volonté, en adoptant la disposition qui figure aujourd’hui à l’article L. 2151-1 du code des transports, de conférer un caractère exclusif au régime de responsabilité issu du règlement européen.
14.- L’exclusivité du régime européen ayant toutefois été décrétée par la première chambre civile, que reste-t-il des régimes de responsabilité français qui s’appliquaient jusqu’à maintenant en matière de transport ferroviaire interne de personnes ?
De l’obligation de sécurité de résultat « à la française », il ne devrait plus rien rester ou presque. En effet, la Cour de cassation ne faisait peser cette obligation sur la SNCF qu’en matière de transport interne, uniquement vis-à-vis du voyageur disposant d’un billet et seulement pour la phase courant du moment où le voyageur commence à monter dans le train jusqu’au moment où il achève d’en descendre[23]. Or les dommages subis pendant cette phase relèvent désormais du régime européen qui couvre, selon l’article 26, § 1, de l’annexe I du règlement, les dommages « résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte ». L’obligation de sécurité de résultat pourrait conserver un domaine d’application très résiduel en cas d’agression du voyageur par un tiers, mais cela est très incertain, ainsi que nous le verrons un peu plus bas[24].
Les régimes délictuels – responsabilité pour faute et responsabilité du fait des choses – continueraient quant à eux à s’appliquer, mais avec un champ d’application restreint. En effet, la Cour de cassation appliquait ces régimes en cas de dommage subi par un voyageur sans titre de transport, en considérant que la responsabilité contractuelle ne pouvait jouer en l’absence de contrat[25]. Or la Cour de justice de l’Union européenne juge quant à elle « qu’une situation dans laquelle un voyageur monte à bord d’un train librement accessible en vue d’effectuer un trajet sans s’être procuré de billet relève de la notion de “contrat de transport” » au sens du règlement[26]. Les régimes délictuels français verront donc probablement leur champ d’application réduits aux accidents qui surviennent avant et après l’exécution du voyage, c’est-à-dire essentiellement aux accidents de quai[27] et aux accidents de correspondance[28], ainsi potentiellement qu’aux dommages subis par les voyageurs qui se sont introduits sans billet dans un train non « librement accessible ».
Cette substitution du régime européen aux régimes français emporte un certain nombre de conséquences, toutes défavorables aux victimes.
II. Les conséquences de l’application exclusive du régime européen
15.- Le régime issu du règlement européen de 2007 apporte certains droits nouveaux aux voyageurs qui ne figuraient pas dans les régimes français de responsabilité, comme l’obligation pour le transporteur de verser une avance à la victime en cas de dommage corporel[29]. Toutefois, le fait de conférer un caractère exclusif à ce régime emporte aussi son lot d’inconvénients pour les victimes d’un accident ferroviaire interne en France, certaines dispositions du règlement constituant un recul certain des droits des victimes par rapport aux régimes français de responsabilité qui étaient jusqu’à lors applicables.
L’arrêt du 11 décembre 2019 acte le premier de ces reculs : la faute simple de la victime peut de nouveau exonérer partiellement le transporteur de sa responsabilité (A). D’autres conséquences défavorables aux victimes, non explicitées dans cet arrêt, sont à prévoir (B).
A. La faute simple de la victime de nouveau exonératoire
16.- Procédé désormais usuel depuis l’évolution du mode de rédaction de ses décisions, la Cour de cassation fait référence à sa propre jurisprudence dans l’arrêt commenté. Ainsi que nous l’avons vu, par deux arrêts très commentés de 2008 dont un de chambre mixte, la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure »[30]. Autrement dit, contrairement au droit commun de la responsabilité civile, la faute simple de la victime ne pouvait plus exonérer partiellement le transporteur ferroviaire de sa responsabilité découlant de la violation de son obligation de sécurité de résultat.
La Cour de cassation qualifie cette jurisprudence de « constante » alors qu’elle est issue de deux arrêts de 2008 qui n’ont à notre connaissance jamais été confirmés. Pis, deux arrêts postérieurs avaient reconnu un caractère partiellement exonératoire à la faute simple de la victime vis-à-vis d’un transporteur fluvial en matière contractuelle[31] et vis-à-vis de la SNCF en matière de responsabilité délictuelle du fait des choses[32], conduisant la doctrine à s’interroger sur une potentielle remise en cause de la jurisprudence de 2008[33]. L’arrêt du 11 décembre 2019 permet de comprendre rétrospectivement que la Cour de cassation n’avait jamais eu l’intention de revenir sur la solution dégagée en 2008 et que les deux arrêts précités se contentaient de préciser la portée de cette jurisprudence : seul le transporteur ferroviaire qui voyait sa responsabilité contractuelle recherchée sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat ne pouvait s’exonérer partiellement.
17.- Constante ou non, cette jurisprudence, aujourd’hui, n’est plus. Selon les termes de la première chambre civile, « il y a lieu de modifier [cette] jurisprudence » puisque le régime européen, désormais seul applicable, érige la faute simple de la victime en cause partiellement exonératoire du transporteur ferroviaire (art. 26, § 2, b, de l’annexe I). La formule sous-entend que ce serait la Cour de cassation qui modifierait sa propre jurisprudence, ce qui ne semble pas totalement cohérent avec le raisonnement déployé par la Haute juridiction dans son arrêt. Selon ce raisonnement, le règlement européen substitue au régime jurisprudentiel français de l’obligation de sécurité de résultat un nouveau régime de responsabilité. Le changement du droit positif quant au caractère exonératoire de la faute simple de la victime ne résulte donc pas d’une « modification de la jurisprudence », mais plutôt de l’adoption d’un nouveau régime de responsabilité – le régime européen – qui rend caduque la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien régime – l’obligation de sécurité de résultat[34].
18.- On pouvait voir dans cette jurisprudence de 2008, diversement appréciée, la volonté de la Cour de cassation d’aligner le régime de responsabilité du fait des accidents ferroviaires sur le régime de responsabilité du fait des accidents de la circulation issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985[35]. La sévérité de la jurisprudence vis-à-vis du transporteur ferroviaire, qui se manifestait également dans l’appréciation des conditions de la force majeure, conduisait à faire de la SNCF un quasi-assureur[36]. Compte tenu du monopole dont jouissait la SNCF en France et de son statut d’entreprise publique, celle-ci était en mesure d’indemniser les accidents subis par les voyageurs même s’ils ne lui étaient pas imputables moralement, en grande partie par l’endettement. Finalement, on était proche d’un régime d’indemnisation par recours à la solidarité nationale. L’ouverture progressive du marché à la concurrence[37] et l’explosion de la dette de la SNCF (de l’ordre de 50 milliards d’euros) expliquent peut-être en partie la décision de la Cour de cassation d’abandonner ce régime qui, bien que très favorable aux victimes, ne prenait guère en compte les intérêts, également légitimes, du transporteur ferroviaire.
Au-delà du retour de l’exonération pour faute simple de la victime, l’arrêt du 11 décembre 2009 devrait entraîner d’autres conséquences défavorables pour les victimes.
B. Les autres reculs des droits des victimes
19.- Si le règlement de 2007 fait peser sur le transporteur ferroviaire une responsabilité de plein droit, son régime est à certains égards moins avantageux pour les victimes que celui de l’obligation de sécurité de résultat construite par la Cour de cassation.
20.- Les causes exonératoires sont ainsi beaucoup plus généreuses pour le transporteur sous l’empire du régime européen. Non seulement la faute simple est une cause d’exonération, ainsi que nous venons de le voir, mais la force majeure est en outre admise plus largement. Celle-ci se caractérise en droit français par son extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité, trois critères qui, de surcroît, étaient appréciés très restrictivement par la Cour de cassation en matière de transport ferroviaire de personnes[38]. Sous l’empire des RU-CIV, l’exonération totale est acquise s’il est démontré que l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ou par le comportement d’un tiers « que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier » (art. 26, § 2, a et c de l’annexe I du règlement).
21.- Le régime de la prescription de l’action en réparation fondée sur le règlement est également très défavorable aux victimes. L’action est prescrite dans un délai de trois ans à compter du lendemain de l’accident (art. 60, § 1, a, de l’annexe I du règlement) contre un délai de dix ans courant à compter de la consolidation du dommage corporel pour les actions fondées sur l’obligation de sécurité de résultat du droit français (art. 2226 du code civil).
22.- Enfin, la responsabilité du transporteur en cas d’agression d’un voyageur pourrait également être affectée par cet arrêt du 11 décembre 2019. Cela dépendra de l’interprétation qui sera faite de l’article 26, § 1, de l’annexe I du règlement qui dispose que « le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire ». L’agression d’un voyageur par un autre dans un train peut-elle être qualifiée « d’accident » et, le cas échéant, cet accident est-il « en relation avec l’exploitation ferroviaire » ? Les avis sur le sujet sont partagés[39].
Si la réponse est positive, alors il résulte de cet arrêt du 11 décembre 2019 que la victime devra nécessairement fonder son action sur le régime du règlement européen avec les inconvénients que nous venons d’exposer. Mais si la réponse est négative, alors une nouvelle difficulté d’interprétation devra être résolue avec deux solutions envisageables. Selon la première branche de l’alternative, le transporteur ne pourra voir sa responsabilité engagée puisque le règlement est d’application exclusive et qu’on l’interprète comme excluant la responsabilité du transporteur en cas d’agression du voyageur[40]. Cela constituerait un recul considérable des droits des voyageurs puisque la jurisprudence de la Cour de cassation leur était très favorable en cas d’agression, le fait du tiers étant très rarement considéré comme un cas de force majeure[41]. Selon une seconde branche de l’alternative, le règlement de 2007 pourrait être interprété comme excluant de son champ d’application les agressions, l’obligation de sécurité de résultat du droit français conserverait alors un champ d’application résiduel sur ce point.
[1] 10e ch., n° 16/16014.
[2] Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307 ; D. 2008, p. 3079, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2009, p. 461, note G. Viney ; ibid., pan. 972, obs. H. Kenfack ; ibid. 2010., pan. 49, obs. O. Gout ; JCP G 2008, II 10011, obs. P. Grosser ; ibid. 2009, I 123, n° 12, obs. P. Stoffel-Munck ; Gaz. Pal. 2009, p. 491, avis M. Domingo, note P. Oudot ; RCA 2009, n° 4, obs. S. Hocquet-Berg ; RLDC 2009/56, n° 3415, note J. Julien ; RTD civ. 2009, p. 129, obs. P. Jourdain ; RDC 2009. 487, obs. T. Génicon. V. aussi Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12.551 ; D. 2008, AJ 920, obs. I. Gallmeister ; ibid., chron. C. cass. 2363, n° 7, obs. C. Creton ; ibid. pan. 2894, obs. P. Brun ; ibid. 2009, pan. 972, obs. H. Kenfack ; JCP G 2008, actu. 219, obs. M. Brusorio-Aillaud ; ibid. II 10085, note P. Grosser ; ibid., I 186, n° 8, obs. P. Stoffel-Munck ; CCC 2008, n° 173, obs. L. Leveneur ; RCA 2008, étude n° 6, note S. Hocquet-Berg ; ibid., n° 159, obs. F. Leduc ; LPA 6 août 2008, note C. Quezel-Ambrunaz ; RTD civ. 2008, p. 312, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2008, p. 843, obs. B. Bouloc.
[3] L’entrée en vigueur de certaines dispositions du règlement pouvait être retardée par les États membres, mais ce n’est pas le cas des dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas de dommage aux voyageurs ou aux bagages. Celles-ci sont entrées en vigueur dès le 3 décembre 2009 (art 2, § 3, du règlement), ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt.
[4] P. le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats 2018-2019, 5e éd., Dalloz, n° 3314.24 par C. Bloch ; S. Bernigaud, I. Bon-Garcin, O. Gout et alii, Droit du transport de passagers, Larcier, 2006, n° 99.
[5] M. Troper, La philosophie du droit, 4e éd., PUF, coll. Que sais-je ?, 2015, p. 60.
[6] Ainsi, selon Cyril Boch, la formule ambiguë de l’article 11, « interprétée de façon compréhensive, […] est de nature à permettre à notre droit interne actuel de se maintenir » (op. cit.) de sorte que « rien n’oblige la Cour de cassation à revoir sa position » (obs. sous Cass. 1re civ., 13 mars 2008, JCP G 2015, doctr. 1409).
[7] S. Bernigaud, I. Bon-Garcin, O. Gout et alii, Droit du transport de passagers, Larcier, 2006, n° 99 et 103 ; S. Piedelièvre et D. Gency-Tandonnet, Droit des transports : transports terrestres, aériens et maritimes, LexisNexis, 2013, n° 457, 473 et 474 ; C. Paulin, « Règlement relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires », Rev. dr. transp. 2008, comm. 25. V. aussi J. Knetsch, « Réforme de la responsabilité civile : faut-il soumettre les accidents ferroviaires au régime de la loi Badinter ? », D. 2019, p. 138, pour qui « les règles de responsabilité actuelles […] du code civil […] ne sont applicables que sur renvoi exprès ou, en cas de transport interne, dans la mesure où une disposition s’avère plus favorable pour le demandeur ».
[8] Aix-en-Provence, 1re et 6e ch. réunies, 5 sept. 2019, n° 18/11198 ; 10e ch., 2 juin 2016, n° 15/08384 ; 10e ch., 10 sept. 2015, n° 14/12200.
[9] Angers, ch. civ. A, 6 mars 2018, n° 16/00131 ; V. Douai, 3e ch., 22 juin 2017, n° 16/03119 ; Dijon, 1re ch. civ., 20 juin 2017, n° 15/02242.
[10] Art. 27 et 28 de l’annexe I du règlement.
[11] S. Piedelièvre et D. Gency-Tandonnet, op. cit., n° 455 et 456.
[12] Rép. civ. Dalloz, v° Renvoi préjudiciel, n° 117 et s.
[13] CJCE, 6 oct. 1982, CILFIT c/ Ministère de la santé, aff. 283/81, Rec. 3415, point 16.
[14] V. par ex. P. Delebecque, Énergie – Env. – Infrastr. 2016, comm. 48.
[15] Poitiers, 1re ch. civ., 8 avr. 2016, n° 14/04688. Également en ce sens, mais moins explicite, V. Paris, pôle 2, ch. 3, 9 mai 2016, n° 14/20974.
[16] Considérants 1 et 2 du règlement.
[17] C. Paulin, note sous Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, Gaz. Pal. 4 juin 2015, n° 226h7, p. 17. Dans le même sens, V. les obs. de P. Jourdain sous le même arrêt, RTD civ. 2015, p. 628.
[18] Selon la disposition qui a habilité le Gouvernement à effectuer cette codification par ordonnance, « les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance » (art. 92, I, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures), l’ordonnance de codification n’a donc pas pu modifier le sens de la disposition codifiée à l’article L. 2151-1 du code des transports. V. aussi P. Delebecque, « Le code – à droit constant – des transports : une œuvre monumentale encore perfectible », D. 2010, p. 2715.
[19] Amendement n° 132 déposé sur le texte n° 501 (2007-2008) en première lecture devant le Sénat (http://www.senat.fr/amendements/2007-2008/501/jeu_classe.html).
[20] Séance publique du Sénat du 9 mars 2009 (http://www.senat.fr/seances/s200903/s20090309/s20090309003.html#section294).
[21] Disposition aujourd’hui codifiée à l’article L. 2151-1 du code des transports. V. l’article précité de P. Delebecque.
[22] Disposition aujourd’hui codifiée à l’article L. 2151-2 du code des transports. V. l’article précité de P. Delebecque.
[23] Arrêt Valverde, Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11.493.
[24] V. infra, n° 22.
[25] Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-12.540.
[26] CJUE, 7 nov. 2019, aff. C‑349/18 à C‑351/18, NMBS c/ Mbutuku Kanyeba, Larissa Nijs et Jean-Louis Anita Dedroog.
[27] Arrêt Valverde précité de 1989 ; V. S. Bernigaud, I. Bon-Garcin, O. Gout et alii, op. cit., n° 100.
[28] La Cour de cassation a en effet jugé que les accidents subis par un voyageur lors d’un changement de train ne relèvent pas du champ du contrat de transport (Cass. 1re civ., 19 févr. 1991, n° 89-19.999 ; S. Bernigaud, I. Bon-Garcin, O. Gout et alii, op. cit., n° 101) et le régime de responsabilité du règlement ne s’applique qu’aux accidents « survenu[s] pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires » (art. 26, § 1, de l’annexe I).
[29] Art. 13 du règlement.
[30] Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307. V. aussi Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12.551.
[31] Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13.440 ; D. 2015, p. 1137, note D. Mazeaud ; ibid., p. 2283, obs. M. Bacache ; RTD civ. 2015, p. 628, obs. P. Jourdain ; JT 2015, n° 175, p. 14, obs. X. Delpech ; Gaz. Pal. 4 juin 2015, n° 226h7, p. 17, note C. Paulin ; JCP G 2015, doctr. 1409, obs. C. Bloch.
[32] Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.217 ; D. 2016, p. 766, note N. Rias ; ibid., p. 1396, obs. H. Kenfack ; ibid. 2017, p. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz.
[33] V. les observations et notes citées dans les deux notes précédentes.
[34] Certes, le régime de responsabilité des RU-CIV repris par le règlement de 2007 a également pour fondement une obligation de sécurité rattachée au contrat de transport (JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 470-40 : « Transport terrestre – Responsabilité du transporteur international de voyageurs et de bagages » par M. Alter et F. Turgné, nov. 2006, n° 29), mais il s’agit de deux régimes de responsabilité distincts aussi bien quant à leurs conditions que quant à leurs effets malgré l’existence de certains points communs.
[35] C. Bloch, obs. sous Cass. 1re civ., 13 mars 2008, JCP G 2015, doctr. 1409.
[36] M. Mekki, Gaz. Pal. 6 oct. 2011, n° GP20111006011, p. 13.
[37] Ce mouvement devrait être parachevé avec l’ouverture à la concurrence des services purement intérieurs de de transport ferroviaire de personnes qui entrera en effet fin 2020 sous réserve de certains mécanismes transitoires qui pourraient temporairement limiter les effets de cette ouverture à la concurrence (V. G. Eckert, « Concurrence et régulation », RFDA 2018, p. 866).
[38] S. Bernigaud, I. Bon-Garcin, O. Gout et alii, op. cit., n° 103.
[39] S. Bernigaud, I. Bon-Garcin, O. Gout et alii, op. cit., n° 97.
[40] C’est cette interprétation qui était retenue par certains auteurs pour les transports internationaux qui, pour rappel, sont également soumis aux RU-CIV de la COTIF (S. Piedelièvre et D. Gency-Tandonnet, op. cit., n° 472 ; JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 470-40 précité, n° 33). Ces auteurs réservent tout de même l’hypothèse d’une « négligence inadmissible » de la part du transporteur ayant permis l’agression, fait qui serait de nature à engager la responsabilité du transporteur international sur le fondement des RU-CIV.
[41] S. Bernigaud, I. Bon-Garcin, O. Gout et alii, op. cit., n° 103.