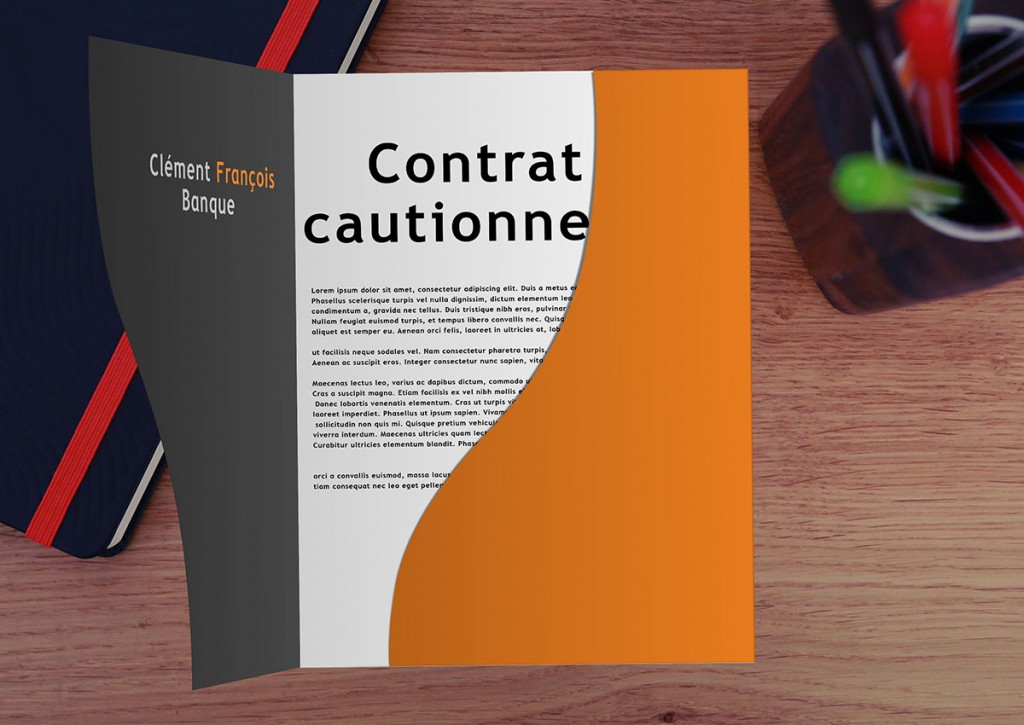Obs. sous Cass. civ. 1re, 6 juin 2012 (n° 11-20.062, à paraître) :
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 6 juin 2012 un arrêt en matière de partage successoral où se mélangent soulte, délai de paiement et méthode de calcul de la lésion, de quoi donner une solution intéressante à analyser aussi bien techniquement qu’en opportunité.
En l’espèce, les biens des successions des père et mère de deux enfants ont été partagés entre ces deux derniers par un acte notarié du 3 juin 2002. Les biens attribués à la fille étant d’une valeur supérieure à sa part successorale, elle devait verser une soulte à son frère. Une première partie de cette soulte, d’un montant inconnu, a été payée au moyen de la cession de droits indivis portant sur un bien déterminé. Une deuxième partie de la soulte, d’un montant de 48 500€, est exigible dès la signature de l’acte de partage. Enfin, une troisième et dernière partie de la soulte, d’un montant de 15 300€, est assortie d’un délai de paiement courant jusqu’au 31 décembre 2003, sans intérêt ni indexation. Je passe rapidement sur le fait qu’il existe une contestation portant sur l’interprétation de la quittance donnée dans l’acte de partage, car cela n’a pas d’incidence sur l’apport de l’arrêt (le demandeur au pourvoi conteste avoir reçu la somme de 48 500€ à titre de soulte alors que la Cour d’appel de Bastia a retenu qu’il en avait consenti quittance aux termes de l’acte notarié).
Le reliquat de la soulte reste impayé et, plutôt que de chercher à obtenir le paiement forcé de celle-ci, son bénéficiaire décide de demander la rescision du partage pour lésion de plus du quart (art. 887 anc. C. civ.). Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Probablement parce que les nombreux immeubles attribués à la fille (un appartement, cinq studios et un lot dans un lotissement) ont pris entre temps beaucoup de valeur, et qu’il est alors apparu préférable au copartageant d’obtenir un nouveau partage plutôt que le paiement d’une soulte non indexée et non assortie d’intérêts… L’argumentation développée dans la seconde branche de l’unique moyen est plutôt originale : « il doit être tenu compte, pour le calcul de la lésion, de l’avantage résultant pour un copartageant du délai qui lui a été accordé pour le paiement de la soulte sans intérêt ni indexation ». Selon le demandeur à la cassation, il devrait être tenu compte pour le calcul de la lésion non seulement de l’avantage retiré du délai de paiement accordé sans contrepartie sur les 15 300€, mais aussi de l’avantage retiré du délai qui s’est écoulé depuis l’acte de partage sans que la soulte de 48 500€ n’ait été payée. Autrement dit, en ne payant pas la soulte comptant dès la signature de l’acte de partage, le copartageant s’accorderait en quelque sorte unilatéralement et de facto un délai de paiement qui devrait être pris en compte pour apprécier la lésion, ce délai de paiement ne faisant l’objet d’aucune contrepartie financière (ni intérêt, ni indexation).
La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que « la lésion ne peut jamais résulter que d’une mauvaise évaluation des biens à partager ou d’un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ; que, dès lors, le défaut de paiement prétendu d’une partie de la soulte et l’avantage allégué résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme, sans intérêt, ni indexation, étaient sans incidence sur le calcul de la lésion ».
La soulte peut être analysée en une obligation. Prise sous l’angle de l’actif, l’obligation est une créance, donc un bien qui vient augmenter la valeur du lot de son bénéficiaire. Prise sous l’angle du passif, l’obligation est une dette qui vient au contraire diminuer la valeur du lot du copartageant qui doit la payer. La soulte permet ainsi de rétablir l’équilibre entre la valeur des biens perçus par chaque copartageant et leurs droits respectifs dans l’indivision successorale. Le délai de paiement accordé au débiteur de la soulte dans l’acte de partage n’est par conséquent ni plus ni moins, juridiquement, qu’un terme, donc une modalité de l’obligation. La modalité d’une obligation peut-elle affecter la valeur de cette obligation? Indéniablement. Nul doute qu’une créance de 100 affectée d’un terme de dix ans sans intérêt ni indexation pourra être cédée à un prix moindre qu’une créance de 100 déjà exigible, le cessionnaire prendra en effet un risque beaucoup plus important avec une créance à terme, il courra d’abord le risque que le débiteur devienne insolvable d’ici l’échéance, et il s’exposera également aux effets de la dévaluation monétaire. On peut donc en conclure que la valeur réelle d’une soulte assortie d’un délai de paiement sans intérêt ni indexation est inférieure à sa valeur nominale, dès lors il paraitrait plus équitable de prendre en compte la valeur réelle et non pas la valeur nominale de la soulte pour apprécier la lésion du quart.
Une seconde interprétation est cependant possible qui expliquerait la solution de la Cour de cassation. Le délai de paiement consenti dans l’acte de partage pourrait être analysé en un crédit consenti, à défaut de stipulation contraire, à titre gratuit (M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz action, 2008, 271.83). Le crédit serait, dans une certaine mesure, détachable de l’acte de partage. Ce crédit ne participerait pas activement à l’opération de partage (en influant sur la valeur des lots) mais trouverait sa cause dans un élément extérieur à l’opération de partage, ce serait un « service d’ami » pour reprendre l’expression du doyen Carbonnier (Variations sur les petits contrats in Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 2001, p. 331), à l’instar du mutuum stipulé sans intérêt. Cette seconde interprétation ne parait pas moins équitable que la première dans la mesure où le copartageant avait tout le loisir de stipuler des intérêts et une clause d’indexation dans l’acte de partage, rien ne l’obligeant par ailleurs à consentir un délai de paiement (art. 832 dern. al. anc. C. civ.).
En ce qui concerne la fraction de la soulte payable comptant mais restée impayée, la Cour de cassation refuse également de prendre en compte le délai écoulé pour calculer la lésion. Cette fois la solution semble s’imposer, il ne faut pas mélanger la question de la valeur du lot tel qu’il est défini dans l’acte de partage avec la question de l’exécution de l’acte de partage qui lui est nécessairement postérieure. Il est évident que l’exécution ou la non-exécution d’un contrat ne peut avoir aucune incidence sur la substance de ce contrat. La rescision pour lésion n’est pas une action conçue pour sanctionner un défaut d’exécution du contrat postérieur à la conclusion de ce dernier, mais pour sanctionner un défaut congénital de l’acte. Le droit français offre d’autres moyens au créancier pour obtenir son dû, en l’espèce le copartageant aurait dû employer les voies d’exécution à sa disposition pour obtenir le paiement de la soulte, la rescision pour lésion n’en étant pas une.
Pour conclure on peut constater que la propension du droit civil français au rejet de la lésion comme cause de nullité d’un contrat est toujours bien vivace. Lorsque la loi admet exceptionnellement la rescision pour lésion du partage successoral, la jurisprudence veille à ce que les modalités de calcul de la lésion ne soient pas trop favorables à celui qui se prétend lésé, sans doute avec le dessein louable de préserver la sécurité juridique et la force obligatoire des contrats.
L’arrêt est reproduit in extenso ci-dessous.